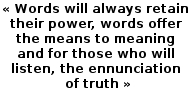Politiques économiques et règne du faux
En matière d’économie, il y a trois grandes typologies de personnes. Il y a ceux qui croient que leur domaine est une science exacte. Ce sont les économistes. Il y a ceux qui croient ceux qui croient que leur domaine est une science exacte. Ce sont les politiques. Et puis il y a ceux qui se font baiser par les deux autres groupes, car de la pratique (ou la théorie) de l’économie à l’économie réelle, il y a un univers.
Prenons un exemple simple. Nicolas Sarkozy qui est un adepte intégriste de la méthode Coué répète ad nauseam « travailler plus pour gagner plus ». Il a martelé qu’il serait « le président du pouvoir d’achat ». Qu’il irait « chercher le point de croissance » nécessaire « avec les dents ». L’un des moyens emblématiques de sa quête du « plus d’argent dans le porte-monnaie des Français » consiste à permettre aux gens de travailler plus de 35 heures et… de convertir leurs RTT en argent sonnant et trébuchant. Il paraît que cela va changer la face de l’économie française.
Pour l’instant, les cadres disent qu’ils ne sont pas tellement concernés vu qu’ils font largement plus que 35 heures par semaine sans être payés en heures supplémentaire et pour les autres… ils sont près de 80 % à expliquer qu’ils ne feront pas racheter leurs RTT par leur entreprise [1]. Il faut dire aussi, pour que tout soit clair, que dans ce pays, seuls 38% des salariés disposent de RTT. En outre, 52% des salariés interrogés estiment qu’une meilleure santé des entreprises pourrait améliorer leurs salaires plutôt qu’une action gouvernementale. Les Français sont des ingrats. Alors, à quoi ça sert que Sarkozy il se décâârcââsse ?
Figurez-vous que ces mauvais coucheurs ont le moral dans les talons. Que dis-je, au 4ème sous-sol. Il est au plus bas depuis 1987. A chaque mois son petit lot de confiance en moins. L’indicateur qui la mesure a encore chuté de trois points en mai 2008, à – 41 contre – 38 (révisé) en avril, soit son niveau le plus bas depuis 1987 « à données comparables », précise perfidement l’Insee. Il s’agit de la onzième baisse consécutive de cet indicateur. Rappelez-nous la date de l’élection de Nicolas Sarkozy ? C’était il y a combien de mois ? Elle est peut-être là « la rupture » finalement ?
Les ménages se montrent particulièrement pessimistes sur l’évolution passée et à venir du niveau de vie en France. « Mauvais signe pour la consommation des ménages, traditionnel moteur de la croissance française, le solde sur “l’opportunité de faire des achats importants” fléchit également en mai (en baisse de deux points à -31), à son plus bas niveau depuis l’automne 1996 » souligne encore Le Monde (tout aussi perfidement que l’Insee).
Autre révélateur de la dichotomie entre l’économie vue de l’Elysée ou de Matignon et l’économie réelle : alors que le nombre de chômeur baisse miraculeusement – souvent à grands coups de radiations un peu trop spontanées pour être honnêtes -, l’opinion des ménages sur les perspectives d’évolution dudit chômage se dégrade également.
Prévisionite et réalité
Maintenant, un exemple un peu plus complexe. Comment les discours des responsables économiques tentent de ramener la confiance là où les fondamentaux disent que tout va mal ?
Les banques centrales, l’OCDE, les pays – dont la France – multiplient ces derniers temps les messages rassurants : le pire de la crise des subprimes est derrière nous. Les prévisions (globales) économiques de l’OCDE laissent entendre que, compte tenu de la rudesse de la crise, les pays membres ne s’en tireront pas trop mal en 2009. Le gouverneur de la Fed, Ben Bernanke, s’il s’inquiète de la hausse du pétrole, a minimisé celle (la plus forte depuis 22 ans) du taux de chômage aux Etats-Unis en mai.
Pourtant, les signes envoyés par la réalité économique ne sont pas très encourageants. Le Wall Street Journal et le Financial Times évoquaient par exemple il y a peu les pertes de Lehman Brothers et ses besoins de capitaux. Un nouveau coup dur pour le secteur après Bear Stearns. Le titre UBS a par ailleurs souffert au cours de la semaine du 9 juin, les analystes tablant sur de nouvelles dépréciations (WSJ).
Plus généralement, dans un bref éditorial titré « Courte vue : le pétrole et le dollar », le FT explique que le risque d’une récession américaine n’est pas totalement écarté. L’IHT rapporte pour sa part les propos alarmants de Jean-Claude Trichet sur les risques d’un choc pétrolier.
Pourquoi les responsables économiques tentent-ils de rassurer ? Parce qu’ils veulent éviter que la crise ne s’aggrave. La déprime engendre la déprime et le tout mène à la récession.
Tout comme Nicolas Sarkozy chez lui avec sa méthode Coué, il convient de marteler à l’échelle de la planète que tout va bien, car ceux qui ont un réel effet sur l’économie ne sont pas contrôlé par ces prêcheur d’optimisme forcé.
Ce sont les banques et plus largement les marchés et les institutions financières. Or celles-ci sont dans un état assez déplorable, n’en déplaise à leurs dirigeants qui affirment également que tout va bien.
Ces acteurs de la finance sont incontrôlables. Ce n’est pas un anarcho-gauchiste qui le dit, mais les tenants du libéralisme. Antilibéral n’est en effet pas exactement le meilleur qualificatif pour le Financial Times.
Pourtant, depuis quelques mois, le quotidien financier (et le Wall Street Journal (encore plus libéral) dans une moindre mesure) multiplie dans ses colonnes les appels à plus de régulation pour les institutions financières.
L’auto- régulation par les banques, les marchés, et plus généralement les tenants du système libéral, aurait fait la preuve de son échec cuisant lors de la dernière crise, dite des subprimes.
Dans son édition du lundi 9 juin, le FT donnait la parole à Tim Geithner, président de la Réserve fédérale de New York. « Le système américain [de contrôle des banques commerciales et d’investissement] est un mélange confus de responsabilités diffuses (…) et de règles qui créent une stimulation perverse et ouvrent la porte à de vastes occasions de dérobade ».
Lors de crises financières ou de faillites retentissantes, les banques brandissent le spectre du risque systémique (effet domino) : si l’une ne peut faire face à ses obligations, les autres risquent de suivre. L’Etat (souvent libéral) – et donc le contribuable (catégorie trois selon la définition posée en introduction) (NYT) -, vient généralement à la rescousse, oubliant ainsi le rôle de la « main invisible ».
Réalité et fiction
« Ce que vous nous racontez est une fiction M. le ministre », indiquait récemment un auditeur d’une radio à un ministre qui expliquait doctement que les salariés allaient pouvoir négocier dans leur entreprises le fait de pouvoir travailler plus. « Dans une entreprise, c’est la direction qui impose aux salariés de travailler plus ou moins, en fonction des commandes », indiquait l’auditeur, armé de du fameux bon sens populaire qui fait cruellement défaut aux dirigeants politiques. A croire que la troisième catégorie n’est pas tout à fait satisfait de sa position et de ce qu’elle implique…
C’est en effet une fiction qui est racontée par Nicolas Sarkozy et son gouvernement en matière de politiques économiques. C’est le « règne du faux » si bien théorisé puis appliqué par George Bush avant lui. Une façon de transformer le sens des mots avec un aplomb confondant. Renverser le sens des mots. Non, non, le supplice de la baignoire, ce n’est pas de la torture, ce sont des méthodes d’interrogatoire pour lutter contre la menace terroriste et protéger les américains contre un danger immédiat et permanent.
Mais Nicolas Sarkozy ne manie pas que le concept du règne du faux. Il manie également très bien la maskirovska. C’est amusant pour un tenant de la « droite décomplexée », c’est à dire de la frange la plus dure de l’UMP, mais Nicolas Sarkozy nous remet au goût du jour une technique très prisée par le KGB, les services secrets (civils) de l’ex-URSS.
Qu’est-ce donc qu’une maskirovska ? Un système simple et probablement vieux comme le monde qui prenait tout son sens en pleine guerre froide. Il s’agissait de détourner l’attention de l’adversaire (les Américains) et d’agir là où ils ne l’attendaient pas. En clair, on crée un incident à un bout de la planète sur lequel se focalise Washington, on commence des palabres sans fin et pendant ce temps, on réalise le véritable but de l’action, bien loin de là, à l’autre bout.
Appliqué à la politique, cela donne par exemple l’affaire des 35 heures. Prenez un président de la république qui ne cesse de dire tout le mal qu’il pense des 35 heures. Prenez par ailleurs un patron de l’UMP à qui vous faites dire que les 35 heures doivent mourir cette année.
Malaxez.
Désavouez le patron de l’UMP en disant : « non, non, les 35 heures restent la durée légale du travail, tout ce qui pourrait être fait en plus ne serait qu’heures supplémentaires et donc, des sous en plus dans le porte-monnaie des Français ».
Qu’obtenez-vous ? Une opinion publique, une partie de la presse et des syndicats qui se cabrent en entendant que les 35 heures vont disparaître mais qui se rassurent ou à tout le moins, se calment en entendant que finalement, la durée légale reste à 35 heures.
Opération parfaite. Une vraie maskirovska. Car dans le même temps, à Bruxelles, le président de la république apporte la voix essentielle de la France (sans elle, cela ne se serait pas fait) pour que les ministres du Travail se mettent d’accord sur une proposition visant à porter la durée légale du travail à 65 heures.
Continuez de marteler que celles qui seront faites en plus des 35 heures seront des heures supplémentaires.
Le tour est joué.
Là où la presse a vu un patron de l’UMP fusible et tête de turc de Nicolas Sarkozy, Aporismes.com voit plutôt un ineffable duo qui a fonctionné au diapason.
Et si l’on invebtait une quatrième catégorie pour que ceux qui le souhaitent puissent sortir des trois autres ?
[1] sondage bLH2/Les Echos/L’Institut de l’entreprise publié lundi 9 juin